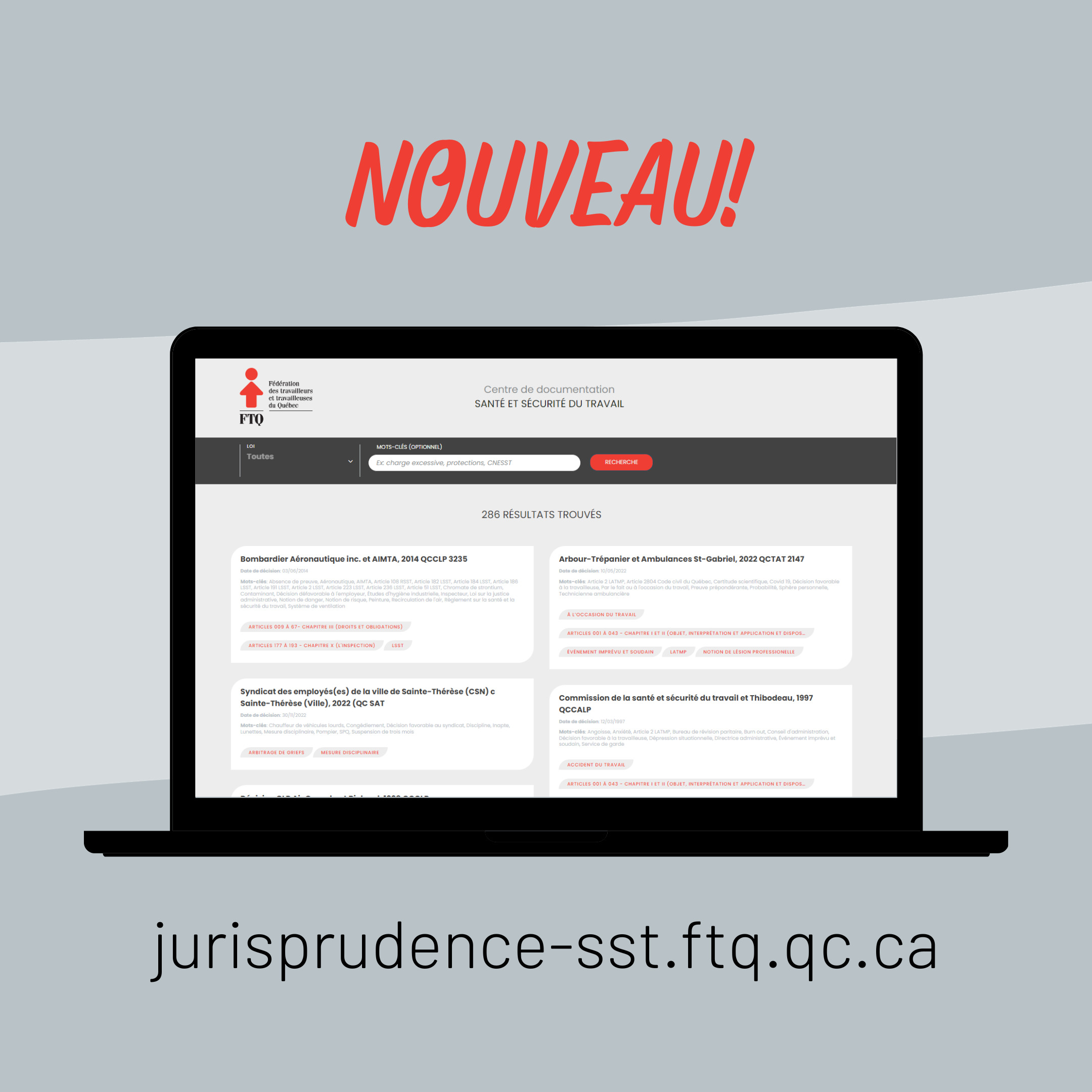2003.03.13
2003.03.13
Une artisane de la cause des femmes à la FTQ : Lauraine Vaillancourt honorée pour l’ensemble de sa carrière
Toujours active, énergique et rayonnante à 72 ans, Lauraine Vaillancourt méritait bien la Médaille de l’Assemblée nationale qui lui a été remise en novembre dernier pour l’ensemble de sa carrière féministe, politique et syndicale.
C’était le 14 novembre 2002, à l’occasion d’une fête soulignant les dix années d’existence de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. Notre syndicaliste à la retraite – vraiment ? – préside les destinées de cette corporation de développement économique communautaire depuis sept ans.
Une des artisanes de la promotion des femmes au sein de la FTQ moderne, Lauraine a été grandement touchée par les hommages qu’on lui a rendus. «C’est unique dans une vie. C’est comme un rêve.» Après quelques minutes de réflexion, elle ajoute : «Ça arrive à point. Parce qu’étant à la retraite, je n’ai plus rien à prouver…»
Ce qui n’était pas nécessairement le cas lorsqu’elle a fait ses premiers pas au sein du Bureau de la FTQ. «C’était un monde d’hommes, pas habitués à la présence d’une femme lors de leurs réunions. Il fallait que j’y aille fermement et sans détour», dit la principale intéressée.
Henri Massé, l’actuel président de la FTQ, était alors vice-président et jeune dirigeant du Syndicat canadien de la fonction publique. «J’ai connu Lauraine lorsqu’elle militait pour les femmes du vêtement. Quand elle est arrivée comme vice-présidente au Bureau, dans les années 80, elle s’est fait une place et elle a toujours réussi à passer ses messages.»
Des grands moments
Des grands moments, elle en a connu plusieurs au cours de ses 58 années de vie active. Elle en dégage trois : le long processus de réforme du Code civil qui a fait des femmes des citoyennes à part entière avec l’accès au crédit, l’autonomie financière et l’autorité parentale, «comme de pouvoir entrer son enfant à l’hôpital sans la signature du mari»; la vice-présidence de la FTQ qu’elle a occupée pendant huit années, à partir de 1985, «les plus belles de ma vie dans le monde syndical»; ses responsabilités à la condition féminine et à l’éducation au sein de l’Union des ouvrières et ouvriers du vêtement pour dames (l’UIOVD, aujourd’hui le SVTI-FTQ) durant plus de 20 ans.
«J’ai eu l’occasion d’être la porte-parole des travailleuses du vêtement et ça m’a ouvert les portes du mouvement syndical. J’ai fait du syndicalisme d’abord pour faire avancer leur cause. En premier, par l’éducation syndicale, parce qu’on ne peut pas s’occuper de condition féminine sans d’abord faire de l’éducation. Il nous a fallu commencer par apprendre à exiger pour obtenir quelque chose.»
Après toutes ses années de militantisme syndical, sa plus grande peine aura été l’abolition du décret du vêtement le 1er juillet 2000, malgré les efforts de la FTQ et du SVTI pour le protéger. «Les employeurs n’ont pas respecté leur parole, constate-t-elle aujourd’hui. Ils devaient créer des emplois, abolir le travail au noir et relancer l’industrie en échange de la disparition du décret qui fixait les conditions de travail dans le vêtement. À la place, ils donnent plus de travail en sous-traitance.»
Pionnière encore
Depuis son arrivée à la présidence de la CDEC Ahuntsic-Cartierville où, insiste-t-elle, elle représente les syndicats, ses préoccupations sont «teintées» : ouverture de garderies familiales, un club d’appui aux femmes entrepreneures ainsi qu’une plus grande présence des femmes aux postes décisionnels et au sein des différents comités de travail.
| Tour de piste Née à Montréal dans une famille modeste en 1930, Lauraine Vaillancourt devient orpheline de mère à neuf ans. Doté d’un sens critique et d’un esprit ouvert, son père lui insuffle le goût de l’action sociale et politique. À quatorze ans, Lauraine travaille déjà dans un atelier de couture. Au bout de quelques mois, elle réclame avec insistance un poste de presseuse, alors réservé aux hommes. En 1945, à quinze ans, elle se retrouve donc, seule femme, dans une équipe d’hommes de plus de quarante ans. Lauraine sera à l’avant-garde toute sa vie. Elle pratique son métier de presseuse jusqu’en 1980, avec une interruption de quelques années consacrées à l’éducation de ses deux enfants. Ses années de travail s’accompagnent d’une vie syndicale active au sein de l’UIOVD, aujourd’hui le Syndicat du vêtement, du textile et autres industries (SVTI-FTQ). Elle se concentre surtout sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des ouvrières du vêtement : accès à des emplois non traditionnels, salaire égal, congé de maternité, santé-sécurité, accès à la vie syndicale. Son militantisme et son expertise dans le dossier des femmes sont reconnus plus largement lorsqu’elle est élue vice-présidente de la FTQ, en 1985. L’année suivante, elle devient responsable du dossier de la condition féminine et présidente du Comité de condition féminine de la centrale. Ses fonctions l’amèneront à représenter les syndiquées du Québec et du Canada à travers le monde. |